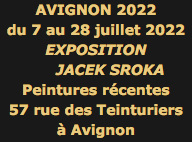|
 |
LEXIQUE DE LA PEINTURE
B
 Bleu
de cobalt : Bleu
de cobalt :  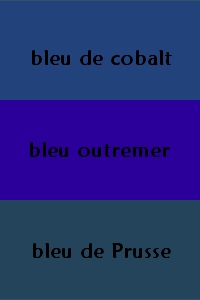
Synonymes : Bleu de Berlin, bleu de Saxe, bleu de Thénard, bleu
hussard.
Pigment inorganique de synthèse qui succède au smalt (aussi
à base de cobalt, mais au pouvoir colorant plus faible) au début
du XIXème siècle. Inaltérable à la lumière,
il présente selon Perego une courbe spectrale avec une remontée
très nette dans le rouge profond, ce qui le rend très sensible
à la qualité de la lumière (modification de l’équilibre
chromatique de l’œuvre et phénomènes de métamérisme).
Bleu plus ou moins profond selon sa teneur en alumine, tirant légèrement
vers le violet, mais moins que le bleu outremer, il est, dispersé
dans un liant, peu lumineux, peu saturé, et assez peu couvrant
(semi-transparent). C’est une couleur siccative, qui peut entraîner
des problèmes accidentels (craquelures, plissements) si elle est
employée sans précaution. Elle reste stable dans les mélanges.
Sources:
Philippe
Ball, Histoire vivante des couleurs. Editions Hazan, 2005.
Mario Brusatin, Histoire des couleurs. Champs, Flammarion, 1996.
Michel Pastoureau, Bleu, histoire d’une couleur. Points, Le Seuil,
2002.
A. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressions de couleur,
le bleu. CNRS
édition, 1998.
Zuppiroli / Bussac, Traité des couleurs, Presses universitaires
romandes, 2003.
François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre.
Editions Belin, 2005. .
Sites à consulter :
pourpre.com
(http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=cobaltbleu)
dotapea.com
(http://www.dotapea.com/bleusfroids.htm#lebleudecobalt)
 Bleu
outremer Bleu
outremer  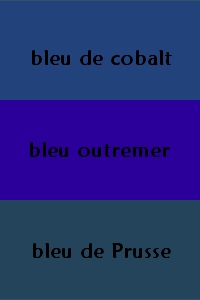
Tiré du lapis-lazuli et employé depuis le moyen âge
précoce (peintures murales en Afghanistan, en Inde et en Chine,
manuscrits byzantins), il est synthétisé au début
du XIXème siècle par Guimet. Il s’agit d’un
bleu violet ou verdâtre (quand le pigment est très fin) dont
la courbe spectrale remonte nettement dans le rouge profond. La version
de synthèse a rapidement supplanté le pigment minéral,
très cher, pour la fabrication des couleurs, et c’est aujourd’hui
le bleu le plus utilisé dans la peinture.
Associé à un liant pour en faire une couleur, il est très
peu lumineux, moyennement saturé, et assez peu couvrant, mais fixe
à la lumière, très transparent et stable dans les
mélanges. Son pouvoir colorant augmente avec la finesse du broyage.
Très sensible aux variations hygrométriques, il peut, s’il
est utilisé pur, s’altérer rapidement (maladie de
l’outremer).
Sources:
Philippe
Ball, Histoire vivante des couleurs. Editions Hazan, 2005.
Mario Brusatin, Histoire des couleurs. Champs, Flammarion, 1996.
Michel Pastoureau, Bleu, histoire d'une couleur. Points, Le Seuil, 2002.
B. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressions de couleur,
le bleu. CNRS édition, 1998.
Zuppiroli / Bussac, Traité des couleurs, Presses universitaires romandes,
2003. François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Editions
Belin, 2005.
Sites à consulter :
pourpre.com
(http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=outremer)
dotapea.com
(http://www.dotapea.com/outremer.htm)
E
 Bleus
de phtalocyanine : Bleus
de phtalocyanine :
Pigments organiques de synthèse apparus vers 1930. Ce sont des
dérivés du cuivre, qui ont des couleurs assez foncées,
très intenses, plus vives que les bleus de Prusse et moins violettes
que les bleus d’outremer, et peuvent prendre des nuances bleu cyan,
bleu turquoise ou bleu paon. Ils possèdent un très grand
pouvoir colorant et une excellente tenue à la lumière.
Dispersés dans l’huile, ils donnent des couleurs fixes à
la lumière, intenses mais très transparentes. Ils sont très
utilisés dans la peinture contemporaine, notamment pour les glacis
et pour nuancer d’autres couleurs (verts et noirs composés).
Sources:
Philippe
Ball, Histoire vivante des couleurs. Editions Hazan, 2005.
Mario Brusatin, Histoire des couleurs. Champs, Flammarion, 1996.
Michel Pastoureau, Bleu, histoire d'une couleur. Points, Le Seuil, 2002.
B. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressions de couleur,
le bleu. CNRS édition, 1998.
Zuppiroli / Bussac, Traité des couleurs, Presses universitaires romandes,
2003. François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Editions
Belin, 2005.
Sites
à consulter :
dotapea.com
(http://www.dotapea.com/bleuschauds.htm#lesbleusphtalo)
 Bleu
de Prusse Bleu
de Prusse  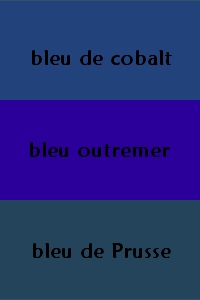
Le bleu de Prusse est un pigment inorganique de synthèse qui apparaît
au début du XVIIIème siècle. Sa courbe spectrale
présente une très légère remontée dans
le rouge, plus ou moins importante suivant les procédés
de fabrication. D’abord employé dans le domaine de la teinture
des tissus, il obtient rapidement un grand succès auprès
des peintres.
C’est un pigment bleu très foncé, très transparent
mais très siccatif et très colorant, qui se rapproche du
noir quand il est dispersé dans l’huile. Il pâlit à
la lumière, mais retrouve sa teinte à l’obscurité.
Employé en fonds, il peut repousser, c’est-à-dire
transparaître à la longue et, adsorbant les siccatifs, brunir
ou verdir avec le temps. Il est moins employé dans la peinture
depuis le milieu du XXème siècle, peu à peu supplanté
par les bleus de phtalocyanine.
Sources:
Philippe
Ball, Histoire vivante des couleurs. Editions Hazan, 2005.
Mario Brusatin, Histoire des couleurs. Champs, Flammarion, 1996.
Michel Pastoureau, Bleu, histoire d'une couleur. Points, Le Seuil, 2002.
B. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressions de couleur,
le bleu. CNRS édition, 1998.
Zuppiroli / Bussac, Traité des couleurs, Presses universitaires romandes,
2003. François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Editions
Belin, 2005.
Sites
à consulter :
pourpre.com
(http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=prusse)
dotapea.com
(http://www.dotapea.com/bleusfroids.htm#lebleudeprusse)
E
 Essence
de térébenthine : Essence
de térébenthine :
Solvant d’origine végétale (pins le plus souvent),
utilisé comme diluant dans la peinture à l’huile.
Elle doit être conservée à l’abri de l’air,
de la lumière et de la chaleur pour lui éviter de graisser
par oxydation.
G
 Glacis
: Glacis
:
Procédé qui consiste à appliquer une couche de couleur
transparente, donc laissant passer la lumière, sur une couche de
couleur opaque, généralement plus claire. Le glacis, destiné
à donner de la profondeur et de l’éclat à la
couche picturale, a longtemps été un procédé
incontournable de la peinture à l’huile.
H
 Huile
sur toile : Huile
sur toile :
Se dit d’une oeuvre exécutée :
1.
Sur un support de toile enduite (coton, chanvre, mais le plus souvent
lin) tendue sur un châssis.
2. avec des couleurs utilisant de l’huile (huile de noix, huile
d’oeillette, huile de lin, huile de carthame…) comme liant
pour les pigments afin de les fixer entre eux et sur le support de l’oeuvre.
|
 |